Recherche clinique
L’unité de recherche clinique
Au cœur des programmes de recherches, les Attachés de Recherche Clinique ont pour mission de permettre l’ouverture de nouveaux protocoles de recherche, d’aider à inclure les patients et de promouvoir les bonnes pratiques cliniques.
Espace Artois, 4ème étage Bureau 415
Horaires : 9h00 – 17h00
Tel : 03.21.21.15.99
Mail : recherche.clinique@gh-artoisternois.fr
Retrouvez la politique Recherche Clinique du GHAT ici.
Vous souhaitez mettre en place une étude dans votre service ?
Tout personnel souhaitant participer à des projets de recherche est reçu ou contacté par le service de recherche clinique.
Une évaluation des demandes est réalisée lors d’une réunion pluridisciplinaire afin d’apporter une réponse personnalisée à chaque projet. Celle-ci comprenant :
- Une analyse méthodologique
- Une analyse réglementaire (ANSM, CPP …) et de faisabilité
- Une analyse de la protection des données personnelles
Pourquoi fait-on de la recherche ?
L’objectif de la recherche clinique est de faire bénéficier les patients volontaires des nouvelles avancées thérapeutiques le plus rapidement possible, améliorant ainsi l’offre de soins. A savoir que l’intérêt des personnes qui se prêtent à la recherche prime toujours sur les seuls intérêts de la science et de la société.
Les études peuvent permettre par exemple :
- De mettre de nouveau médicaments sur le marché
- Evaluer un nouveau dispositif médical
- Améliorer la prise en charge des patients en évaluant les pratiques professionnelles autour d’une pathologie.
- Développer et approfondir les connaissances médicales dans les différentes pathologies ….
Les études sont valorisées sous forme de publication scientifique ou de thèse / mémoire.
Est-ce que la recherche clinique est encadrée par la loi ?
Oui !
La recherche clinique est encadrée par plusieurs textes réglementaires nationaux et internationaux dont la loi Jardé du 5 mars 2012 en application au 16 novembre 2016.
L’ensemble de cette réglementation a pour but de vérifier la pertinence de la recherche, le respect des personnes se prêtant à la recherche et de permettre la bonne qualité des données recueillies.
Pour démarrer, la recherche doit avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes en fonction du type d’étude :
- Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé plus connue sous l’acronyme ANSM (Accueil – ANSM (sante.fr)) + logo
- Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés plus connue sous l’acronyme CNIL (Professionnel | CNIL) + logo
- Comités de Protection des personnes plus connu sous l’acronyme CPP (Les comités de protection des personnes | Agence régionale de santé Hauts-de-France (sante.fr) )
Des professionnels de la recherche clinique sont là pour garantir le bon déroulement des études et le respect des bonnes pratiques cliniques.
Quels sont mes droits en tant que participant à la recherche ?
Le Groupe Hospitalier Artois-Ternois porte un intérêt majeur à la protection de la vie privée et des données personnelles de ses patients. Le document ci-dessous a vocation à informer les patients des modalités de traitements des données personnelles, d’une part, et des droits des patients relatifs à ces traitements, d’autre part.
Pour plus d’information nous vous conseillons de prendre connaissance de la page suivante :
https://www.gh-artoisternois.fr/hopital/vos-droits-et-obligations/vos-droits/
La recherche clinique oui mais pas tout seul ! Découvrez nos partenaires :
Le Groupement régional de la recherche clinique a pour ambition de développer la recherche clinique dans les établissements de santé adhérents du Nord et du Pas-de-Calais pour le bénéfice de leurs patients, grâce à un accès plus facile aux innovations en santé.

Groupement Interrégional de Recherche Clinique et d’Innovation. https://www.girci-no.fr/
Fiche identité de notre CH : Etablissement | GIRCI Nord-Ouest (girci-no.fr)
StARCC : Structuration de l’Activité de Recherche Clinique en Cancérologie
L’équipe StARCC intervient au sein des établissements adhérents afin de favoriser l’accès à l’innovation thérapeutique, augmenter le nombre de patients inclus dans les essais cliniques en cancérologie, améliorer la visibilité de la recherche clinique et optimiser les collaborations avec les promoteurs.
Le réseau réalise également une aide à l’identification d’études cliniques pour les patients présentés en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire afin qu’ils puissent bénéficier de propositions thérapeutiques élargies/innovantes. Nos professionnels de santé peuvent alors les adresser vers les centres de soins proposant ces nouvelles thérapies.
https://www.girci-no.fr/structuration-activite-recherche-clinique-cancerologie-starcc
https://archimaid.fr/index.php?terr=59%20-%2062

Registre des essais cliniques en cancérologie ARCHIMAID :

Structure de recherche opérationnelle sur le Lymphome (LYSARC) http://www.lysarc.org/

PREMOB, réseau consacré à la recherche sur la prévention de la perte de mobilité et des chutes chez les personnes âgées.

Nos registres :
NEPRHONOR Réseau de Prise en Charge de la Maladie Rénale Chronique dans les Hauts-De-France https://nephronor.fr/

Registre du Cancer de la Somme, surveillance des cancers dans la population française, le dispositif des registres de cancer est un outil de référence.
https://www.chu-amiens.fr/chercheurs/le-registre-du-cancer-de-la-somme/
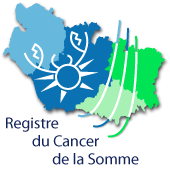
Le Registre Général des Cancers de Lille et de sa région, surveillance des cancers dans la population française, le dispositif des registres de cancer est un outil de référence.
REGISTRE DES CANCERS | ALLIANCE CANCER (alliance-cancer.org)
